 |
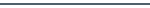 |
|
L'explorateur |
|
Lieux de passage des
explorateurs Champlain
 xplorateur,
cartographe et écrivain, Samuel de Champlain laissa des textes qui nous permettent de
mieux connaître la région avant l'arrivée des grands bouleversements que provoquèrent
la traite des fourrures, les épidémies et les guerres indiennes. xplorateur,
cartographe et écrivain, Samuel de Champlain laissa des textes qui nous permettent de
mieux connaître la région avant l'arrivée des grands bouleversements que provoquèrent
la traite des fourrures, les épidémies et les guerres indiennes.
|
|
 |
 |
|
Est-il
encore nécessaire de présenter Champlain ? Il est né en 1570, à Brouage en Saint-Onge.
Soldat, marin, géographe, explorateur, fondateur de la ville de Québec, de Ville-Marie,
qui devint Montréal, et père de la Nouvelle-France, il passa à deux reprises dans le
Pontiac.En France, Champlain rencontra Nicolas du Vigneau qui affirmait avoir atteint une
mer au nord en moins de dix sept jours, aller-retour à partir de Ville-Marie. En 1613
accompagné de quatre Français, dont du Vigneau et d'un guide indien, Champlain remonta
la rivière des Outaouais et reconnut la rivière Gatineau, la rivière Rideau, les chutes
de la Chaudière, puis termina son périple à l'Île-aux-Allumettes où le chef algonquin
Tessouat nia les affirmations de du Vigneau.Champlain eut toutes les peines du monde à
sauver du Vigneau car les Algonquins, |

Champlain |

et Brûlé |
|
|
disant ne pas
apprécier les menteurs, voulaient l'exécuter. En 1615, il reprit le chemin effectué en
1613, accompagné d'Étienne Brûlé, d'un domestique et d'une dizaine d'Indiens. Il
remonta la rivière des Outaouais jusqu'à la Mattawa. Le 26 juillet 1615, il arriva dans
le lac Nipissing. Il navigua ensuite dans la Baie Géorgienne, sur le lac Huron, en
profita pour aller guerroyer avec un fort parti huron. Il fut blessé deux fois au
cours des combats et hiverna en Huronnie avant de rentrer à Québec l'année suivante. Ce
fut son dernier grand voyage d'exploration. Il se consacra ensuite au développement de la
jeune colonie. |
 |
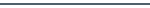 |
|
Le truchement |
|
 ès les premiers contacts entre les Européens et les
Indiens, des volontaires partirent vivre avec les Amérindiens pour former des
interprètes, appelés truchements. Leur rôle fût primordial lors de la naissance de la
Nouvelle-France pour ce qui était de pour fournir des renseignements sur le pays. ès les premiers contacts entre les Européens et les
Indiens, des volontaires partirent vivre avec les Amérindiens pour former des
interprètes, appelés truchements. Leur rôle fût primordial lors de la naissance de la
Nouvelle-France pour ce qui était de pour fournir des renseignements sur le pays.
Ils servirent d'intermédiaires entre les Indiens et les Français et favorisèrent la
bonne entente entre les deux communautés. Par contre, au contact de cette vie libre et
aventureuse, ils développèrent un goût marqué pour la liberté et ne supportèrent
plus aucune des contraintes de la vie civilisée. Ils devinrent très vite les bêtes
noires des Récollets, puis des Jésuites, car ils montraient le mauvais exemple aux
Indiens, allant même jusqu'à gêner les conversions.
Étienne Brulé, truchement et premier découvreur de l'Outaouais.
Né en 1591, il débarqua très jeune à Québec avec
Champlain. Après deux hivers passé à l'Habitation de Champlain sur le site de ce qui
allait devenir la ville de Québec, il partit avec un groupe d'Algonquin vers l'Outaouais,
le Pontiac et la Baie Géorgienne. Il fut certainement le premier Blanc à explorer ces
territoires encore inconnus. Il vécut quelques temps à l'Île-aux-Allumettes.Tour à
tour explorateur, interprète et représentant de Champlain, il eut une vie tumultueuse.
Excellent interprète, il était capable de converser aussi aisément avec des Montagnais,
des Algonquins, des Hurons que des Andastes. |
|
 |
 |
|
En 1615, il fut
chargé par Champlain de rassembler une armée de 500 Andastes pour partir en guerre
contre les Iroquois. Il devait rejoindre Champlain près de Syracuse où celui-ci
assiégeait un village d'Onnontagués avec une armée huronne. Champlain fut blessé deux
fois et dut lever le siège. Brûlé arriva trop tard. Il fut capturé et torturé par les
Iroquois en 1616, mais il parvint à s'enfuir. Les Hurons l'adoptèrent, ce qui ne
l'empêcha nullement de se mettre au service des frères Kirke qui prirent Québec en
1629. Quelques années plus tard, il fut tué par les Hurons qui lui reprochaient ses
turpitudes sexuelles. |
 |
 |
|
|
 Etienne Brûlé Etienne Brûlé |
 |
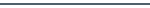 |
|
Le coureur de bois |
|
 vec le développement du commerce des fourrures, les castors se
firent de plus en plus rares. Les Indiens qui fournissaient les peaux, victimes des
guerres tribales et des épidémies, devinrent également plus difficiles d'approche. Vers
l'ouest, de grands espaces vierges où les fourrures étaient encore abondantes
attendaient les aventuriers. Une nouvelle génération de coureur de bois naquit pour
aller au-devant de ces richesses. vec le développement du commerce des fourrures, les castors se
firent de plus en plus rares. Les Indiens qui fournissaient les peaux, victimes des
guerres tribales et des épidémies, devinrent également plus difficiles d'approche. Vers
l'ouest, de grands espaces vierges où les fourrures étaient encore abondantes
attendaient les aventuriers. Une nouvelle génération de coureur de bois naquit pour
aller au-devant de ces richesses.Un riche commerçant
finançait l'expédition, achetait le canot en écorce, la pacotille, les vivres et
embauchait un équipage d'une dizaine d'hommes que l'on nommait des voyageurs. L'équipe
était constituée d'un guide, d'un conducteur de canot, d'un interprète, d'un commis et
d'un équipage souvent débutant. La navigation était difficile et dangereuse, car le
moindre choc contre une rocher ou un bois flottant crevait l'écorce, ce qui gâchait les
vivres. Tous les soirs, le canot était déchargé, sorti de l'eau, inspecté et réparé.
Les journées étaient longues puisqu'ils partaient tôt le matin et ne s'arrêtaient que
tard le soir. Les efforts étaient d'autant plus éprouvants que la nourriture consistait
en une bouillie de mais accompagnée d'un peu de graisse.
À l'automne, avant les premiers frimas, ils choisissaient un lieu
d'hivernement sûr, à proximité d'un village indien et d'un lac ou d'une rivière où
ils pourraient pêcher pour assurer leur subsistance. Ils construisaient un fort et des
logis, le tout sous la direction du commis. L'installation terminée, ils commerçaient
tout l'hiver avec les Indiens et collectaient les fourrures des tribus, même lointaines,
organisant pour ce faire de nombreuses expéditions. Au printemps, les canots chargés de
fourrures reprenaient la route de Montréal. L'arrivée en ville des équipages donnait
lieu à de nombreuses réjouissances et beuveries.Beaucoup de voyageurs se mettaient à
leur compte et, illégalement, commerçaient la fourrure, prenant femme chez les
Amérindiens. Refusant toutes contraintes, ils préféraient la vie sauvage au retour à
la ville, ce qui affaiblissait considérablement la jeune colonie et inquiétait les
autorités qui essayaient par tous les moyens de freiner l'exode. L'Outaouais était l'un
des lieux de passage obligé des coureurs de bois qui profitaient de leur halte au
portage de l'Île-du-Grand-Calumet pour se recueillir sur la tombe du plus célèbre
d'entre eux : Cadieux.
La légende de Jean
Cadieux
Jean Cadieux avait adopté ce mode de vie depuis 1671 et
avait fondé une famille avec une femme algonquine, Marie Bourdon. Il était né à
Boucherville, le 12 mars 1671 de Jean Cadieu et de Marie Valade, dont il était le fils
cadet. Chasseur et trappeur, il traitait avec les Indiens et échangeait des fourrures
contre les provisions et les produits manufacturés qui lui permettaient de passer l'hiver
encabané au fin fond des bois.
Un jour de mai 1709, il descendait avec quelques Indiens de l'île
Morisson à Montréal pour aller vendre des fourrures. Lors d'une halte aux portages des
sept chutes à l'Île-du-Grand-Calumet, l'un de ses |
|
 |
 |
 |
|
compagnons,
un jeune Algonquin parti en reconnaissance, repéra un groupe de guerriers iroquois venu
tendre des embuscades aux voyageurs pour s'emparer des précieuses fourrures. Pour
s'échapper, il fallait franchir des sauts infranchissables et cela, sous une
nuée de flèches ! Afin d'augmenter les chances de survie de ses compagnons et
de sa famille, Cadieux décida avec un jeune guerrier algonquin de faire diversion et
d'attirer les Iroquois loin des rapides pour leur permettre de les franchir en toute
quiétude. Tous se cachèrent au fond de leur canot en amont des rapides, prêts à
partir au signal convenu, soit un coup de fusil.
|

Monument à
|

la mémoire
|

de Cadieux
|
|
|
Une heure plus tard, Cadieux et son compagnon prirent les Iroquois à revers
et les attirèrent loin des rapides. Un échange de coups de feu s'ensuivit : c'était le
signal qu'attendait les compagnons de Cadieux pour s'élancer dans les terribles rapides,
sous l'oeil médusé de quelques Iroquois qui n'en revenaient pas et qui étaient plus
préoccupés à se protéger des assaillants que de tirer sur les fuyards. Avec une
dextérité hors du commun, les canotiers algonquins conduisirent les frêles esquifs
d'écorce au milieu des flots rugissants, évitant tout contact avec les rochers qui
auraient pu déchirer les écorces de bouleaux, ce qui les auraient conduit à une mort
certaine. Deux jours durant, ils naviguèrent à un rythme d'enfer et atteignirent le lac
des Deux Montagnes où ils trouvèrent refuge.
Ne le voyant pas revenir, trois de ses compagnons, après avoir mis familles
et fourrures en sécurité, partirent à la recherche de Cadieux. Les Iroquois avaient fui
l'île et les Algonquins trouvèrent un petit abri de branche vide près du portage des
sept chutes. Les guerriers algonquins partirent à la recherche de leurs compagnons,
lisant les traces laissées par les agresseurs et assaillants comme dans un grand livre.
Le jeune algonquin avait été tué et, trois jours durant, les Iroquois avaient battu
l'île à la recherche de Cadieux qui continuait à guerroyer, aussi insaisissable qu'une
ombre !
Après deux jours de recherches infructueuses, ayant perdu tout espoir de
retrouver Cadieux, ils découvrirent une croix de bois plantée en terre prés de l'abri
qu'ils avaient remarqué à leur arrivée. Et là, à demi enterré, gisait le corps
de Jean. Il tenait entre ses mains une longue écorce de bouleau sur laquelle, avant de
mourir, il avait transcrit sous forme d'une complainte, son épopée.
Il avait réussi à échapper aux Iroquois, mais épuisé, affaibli par
trois jours de guérilla et de privations, il avait vu revenir ses compagnons, mais sans
trouver la force de les héler. Il s'était préparé à la mort, creusant sa tombe et y
plantant une croix après avoir composé sa complainte. Il s'était ensuite enseveli
avec ses dernières forces, attendant la mort en un lieu dit le Petit Rocher de la Haute
Montagne.
Cent cinquante ans plus tard, Jean-Charles Taché relate que la légende de Cadieux était
tellement vivace que les coureurs de bois qui passaient sur l'Outaouais s'arrêtaient sur
la tombe pour prier, entretenir la croix et en prendre un copeau pour leur porter chance.
Certains accrochaient à un arbre proche une copie de la complainte écrite sur une
écorce de bouleau. Taché transcrivit la complainte qui comportait onze couplets et
retrouva un prêtre, le père Cadieux, qui lui confia que Jean Cadieux était le
grand-père de son grand-père.
En 1905, les ouvriers qui construisaient le Palais de justice de Bryson
demandèrent et obtinrent la permission de construire un monument de pierre à la mémoire
de Cadieux à la place de la croix de bois, ce qu'ils firent sans aucune solde, par seule
soucis d'honorer la mémoire de Cadieux. Commença ensuite la guerre des monuments entre
Bryson et l'Île-du-Grand-Calumet, chacun revendiquant le doit de posséder le monument à
la mémoire de Cadieux. Le monument fut saccagé puis détruit par des vandales. Pour le
protéger, les habitants de l'île récupérèrent nuitamment le monument et
l'installèrent dans un parc à l'entrée du village afin de veiller sur lui. |
 |
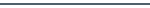 |
|
Un des plus grands chefs indiens |
|
Le
grand chef Pontiac
 tout
seigneur, tout honneur, une MRC de l'Outaouais, des villes et des voitures portent encore
de nos jours son nom et perpétuent son souvenir. Découvrons ensemble ce personnage hors
du commun. tout
seigneur, tout honneur, une MRC de l'Outaouais, des villes et des voitures portent encore
de nos jours son nom et perpétuent son souvenir. Découvrons ensemble ce personnage hors
du commun.
 |
|
 |
 |
|
Né de
père Odawa et de mère Ojibway en 1720 au bord du lac Nipissing, il devint chef des
Ottawa et chef suprême de la confédération des Algonquins des Grands Lacs grâce à ses
qualités de stratège et de communicateur. Allié des Français et ami fidèle de
Montcalm, Pontiac a dirigé les Ottawas au combat et se distingua à la bataille de
Monongahéla en 1755. Après la défaite des Français, les Britanniques furent durs
envers les Indiens. Pontiac reprit la lutte pour reconquérir ses territoires et se
libérer de l'oppression des Britanniques. Fait unique, il réussit à unir dix-huit
nations pour faire la guerre aux Anglais. En mai 1764, il déclencha une insurrection et
pris 9 postes anglais sur 11. La Pennsylvanie, la Virginie et la Nouvelle-York furent
saccagées. |

Pon |

tiac |
|
|
Il passa à deux
doigts de réussir sa conquête, mais le Fort de Détroit, aidée par des
Canadiens-français, résista au siège. Les Britanniques envoyèrent des renforts et
répandirent des épidémies avec des couvertures contaminées dans les villages indiens.
Pontiac dut battre en retraite le 18 août, mais il lutta encore un an malgré l'abandon
de certains alliés. En 1765, le brigadier Bouquet, à la tête de fortes troupes, obligea
Pontiac à abandonner le combat et signer un traité de paix. Malgré cela, Pontiac
voulait continuer la lutte par d'autres moyens ; il tenta de créer un gouvernement
indien, de même qu'il essaya d'envoyer des Outaouais faire des stages en Angleterre pour
apprendre les techniques de fabrication des étoffes afin de créer des industries. Les
Britanniques, craignant ces idées progressistes, brisèrent la réputation de Pontiac en
faisant courir le bruit qu'ils l'avaient achetés. Pontiac fut banni et dut aller vivre
loin de ceux qu'il avait tant aimés et pour lesquels il avait tant lutté. Il mourut
assassiné par un Péorias en 1767. Pontiac fût enterré avec les honneurs militaires dus
à son rang sur les rives du Mississipi par la garnison française des Forts de Vincennes
et de Chartres commandée par le capitaine Louis Saint-Ange de Bellerive. |
 |
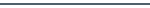 |
|
Le trappeur |
|
 e nombreux coureurs de bois se
sédentarisèrent et optèrent pour un mode de vie mi-occidental mi-indien. Prenant le
meilleur des deux mondes, ils devinrent trappeurs. Vivant dans des cabanes en bois rond,
fabriquant leur canot d'écorce, leurs raquettes, leurs vêtements, vivant libres et sans
contraintes au fond des bois, ils comptaient sur leurs lignes de trappe pour amasser les
fourrures qui leurs permettaient d'acquérir ce qu'ils ne pouvaient produire. Pour assurer
leur subsistance, ils pouvaient affectuer des tâches aussi variées que trapper pour
vendre les peaux et la viande, pêcher, chercher de l'or et des perles de moules d'eau
douce, fabriquer des canots et des raquettes, bûcher et draver. Il y a peu, on
rencontrait encore des trappeurs à l'ancienne dans l'Outaouais, mais l'arrivée de
nouvelles lois réglementant la chasse et la pêche les ont plutôt marginalisés et
rangés du côté des braconniers alors qu'ils ne faisaient que perpétuer le mode de vie
de leurs ancêtres. e nombreux coureurs de bois se
sédentarisèrent et optèrent pour un mode de vie mi-occidental mi-indien. Prenant le
meilleur des deux mondes, ils devinrent trappeurs. Vivant dans des cabanes en bois rond,
fabriquant leur canot d'écorce, leurs raquettes, leurs vêtements, vivant libres et sans
contraintes au fond des bois, ils comptaient sur leurs lignes de trappe pour amasser les
fourrures qui leurs permettaient d'acquérir ce qu'ils ne pouvaient produire. Pour assurer
leur subsistance, ils pouvaient affectuer des tâches aussi variées que trapper pour
vendre les peaux et la viande, pêcher, chercher de l'or et des perles de moules d'eau
douce, fabriquer des canots et des raquettes, bûcher et draver. Il y a peu, on
rencontrait encore des trappeurs à l'ancienne dans l'Outaouais, mais l'arrivée de
nouvelles lois réglementant la chasse et la pêche les ont plutôt marginalisés et
rangés du côté des braconniers alors qu'ils ne faisaient que perpétuer le mode de vie
de leurs ancêtres. |
|
  |
|
(Moteur de
recherche) -----Passeport pour l'Outaouais----- OK |
|
|
|