|
|
|
Plus tard, au cours
du Moyen-Âge, le jeu des alliances politiques et guerrières ainsi que les exigences
économiques ont provoqué divers mouvements de populations à travers le nord-est
américain. Les peintures rupestres découvertes sur de grands pans rocheux à
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff témoignent des visions cosmogoniques et religieuses que
les Algonquins partageaient avec d'autres communautés vivant jusqu'à 2 000 km plus
à l'ouest. À propos des noms des
Amérindiens
L'histoire et la région de l'Outaouais sont émaillées de noms
amérindiens. Or, il faut savoir que ces noms datent du début de l'Amérique occidentale. Les scribes de l'époque écrivaient souvent les
noms d'une manière approximative et l'orthographe de ces derniers changeaient souvent
d'une plume à l'autre. Qui plus est, il arrivait qu'il s'agisse non pas de la
dénomination sous laquelle une nation indienne se reconnaissait, mais plutôt du nom que lui donnait une autre nation. Il va de soi
que ce nom pouvait être positif ou négatif selon que la nation qui vous désignait
était amie ou ennemie ! Par exemple, tout le monde a déjà entendu parler des Esquimauds
ou Esquimaux. Pourtant, il ne s'agit pas du vrai nom de ce peuple arctique. Esquimaux, qui
signifie Ceux-qui-mangent-de-la-viande-crue, est un nom accordé par les Amérindiens
vivant plus au sud. Leur véritable nom
est Inuit, les Hommes. Le nom Algonquin est aussi une déformation de Elaegomogwik qui, en
langue malécite, se traduit par Ceux-qui-sont-nos-alliés. Quant aux renommés Iroquois,
leur nom vient de deux mots de leur langue, hiro et koué. Le premier, hiro, signifie << ainsi que j'ai dit >> ,
une formule qui ponctuait souvent leur discours. Koué était une exclamation pouvant
exprimer la joie ou le chagrin, dépendamment du ton employée, et qu'ils utilisaient à
tout propos. De là est venue leur nom d'Iroquois, nom donné par leurs ennemis.
|
 |
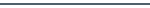 |
|
1603 : premiers contacts avec les Européens |
|
 es premiers contacts entre les Amérindiens et les Européens
remontent à 1603. Quelque 3 000 Algonquins contrôlaient alors l'Outaouais qui
constituait le trait d'union entre les principales zones commerciales de l'est de
l'Amérique du Nord. Cette position stratégique conférait aux Algonquins un rôle très
important d'intermédiaires commerçants, au point d'imposer ce que l'on
appellerait aujourd'hui des droits de douanes pour le passage des marchandises entre le
haut et le bas Outaouais. L'arrivée des Européens, ajoutée à l'importance du
commerce des fourrures, ne tarda pas à déclencher des conflits guerriers qui, conjugués
à de sévères épidémies, décimèrent la nation algonquine au milieu du XVII ième
siècle. Au cours des 150 années suivantes, l'histoire de l'Outaouais fut celle de
la traite des fourrures, les pouvoirs publics et ecclésiastiques européens installant
comptoirs et missions, mais s'opposant à l'implantation d'un peuplement non-autochtone de
peur d'entraver la bonne marche du commerce des peaux avec la nation algonquine. Des
postes de traite, fortifiés pour certains, furent bâtis pour faciliter le commerce,
assurant le rôle de relais pour les coureurs de bois, les
explorateurs, les missionnaires et les expéditions militaires qui utilisèrent la
rivière des Outaouais pour se rendre dans les Grands Lacs. es premiers contacts entre les Amérindiens et les Européens
remontent à 1603. Quelque 3 000 Algonquins contrôlaient alors l'Outaouais qui
constituait le trait d'union entre les principales zones commerciales de l'est de
l'Amérique du Nord. Cette position stratégique conférait aux Algonquins un rôle très
important d'intermédiaires commerçants, au point d'imposer ce que l'on
appellerait aujourd'hui des droits de douanes pour le passage des marchandises entre le
haut et le bas Outaouais. L'arrivée des Européens, ajoutée à l'importance du
commerce des fourrures, ne tarda pas à déclencher des conflits guerriers qui, conjugués
à de sévères épidémies, décimèrent la nation algonquine au milieu du XVII ième
siècle. Au cours des 150 années suivantes, l'histoire de l'Outaouais fut celle de
la traite des fourrures, les pouvoirs publics et ecclésiastiques européens installant
comptoirs et missions, mais s'opposant à l'implantation d'un peuplement non-autochtone de
peur d'entraver la bonne marche du commerce des peaux avec la nation algonquine. Des
postes de traite, fortifiés pour certains, furent bâtis pour faciliter le commerce,
assurant le rôle de relais pour les coureurs de bois, les
explorateurs, les missionnaires et les expéditions militaires qui utilisèrent la
rivière des Outaouais pour se rendre dans les Grands Lacs. |
 |
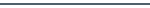 |
|
1800
: la colonisation européenne |
|
 ne vague importante d'Européens déferla sur la région vers
1800, lorsque des colons du Massachusetts prirent possession de terres vierges et fertiles
pour des fins agricoles. L'arrivée de ces immigrants
fit partie du vaste mouvement de colonisation qui balaya le continent d'est en ouest.
Contraintes économiques et démographiques, famines, guerres et promesses de terres
abondantes justifient ce mouvement migratoire. En Outaouais, les Américains
précédèrent les immigrants irlandais, écossais, anglais et les habitants des régions
voisines de l'Outaouais, qui s'y installèrent au début du siècle. On retrouvait alors
des noms qui marquèrent l'histoire outaouaise : Philémon Wright, Archibald
MacMillan, Louis-Joseph Papineau... ne vague importante d'Européens déferla sur la région vers
1800, lorsque des colons du Massachusetts prirent possession de terres vierges et fertiles
pour des fins agricoles. L'arrivée de ces immigrants
fit partie du vaste mouvement de colonisation qui balaya le continent d'est en ouest.
Contraintes économiques et démographiques, famines, guerres et promesses de terres
abondantes justifient ce mouvement migratoire. En Outaouais, les Américains
précédèrent les immigrants irlandais, écossais, anglais et les habitants des régions
voisines de l'Outaouais, qui s'y installèrent au début du siècle. On retrouvait alors
des noms qui marquèrent l'histoire outaouaise : Philémon Wright, Archibald
MacMillan, Louis-Joseph Papineau...
 |
|
|
 |
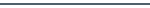 |
|
Les
débuts de l'exploitation forestière et la drave |
|
 u tout début du XIX ième
siècle, l'exploitation forestière, d'abord une activité périphérique à
l'agriculture, prit rapidement le dessus, aidée en cela par les besoins en ressources de
la marine anglaise aux prises avec la France napoléonienne et par l'amélioration des
infrastructures de transport maritime et terrestre. À partir de 1825, l'Outaouais devint
la plaque tournante de l'exploitation forestière en Amérique du Nord. Après 1850, le
débouché principal de l'industrie forestière outaouaise devint le bois de sciage
exporté aux États-Unis. En conséquence, les industries de transformation prirent
de plus en plus d'importance. L'épopée du bois et son flottage sur
les rivières, appelé "la drave", marquèrent les paysages et les gens. u tout début du XIX ième
siècle, l'exploitation forestière, d'abord une activité périphérique à
l'agriculture, prit rapidement le dessus, aidée en cela par les besoins en ressources de
la marine anglaise aux prises avec la France napoléonienne et par l'amélioration des
infrastructures de transport maritime et terrestre. À partir de 1825, l'Outaouais devint
la plaque tournante de l'exploitation forestière en Amérique du Nord. Après 1850, le
débouché principal de l'industrie forestière outaouaise devint le bois de sciage
exporté aux États-Unis. En conséquence, les industries de transformation prirent
de plus en plus d'importance. L'épopée du bois et son flottage sur
les rivières, appelé "la drave", marquèrent les paysages et les gens. Jusqu'en 1871, les recensements s'avéraient peu fiables. On sait que la
population non autochtone ne comptait que quelques dizaines de personnes au début du
siècle. En 1857, quelque cent écoles desservaient environ 4 500 élèves. Les développements économiques ainsi que la mise en place
d'institutions politiques, religieuses, éducatives et légales favorisèrent une immigration rapide, de sorte que l'Outaouais
comptait quelque 81 065 habitants
en 1891. |
 |
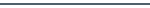 |
|
L'industrialisation |
|
 partir de 1886, Ezra Butler Eddy innova dans
l'industrie du traitement des produits forestiers ; il fut un véritable pionnier dans
l'utilisation de nouveaux procédés industriels, telles la fabrication de la pâte
mécanique et chimique et l'utilisation de lessiveuses en forme de tour. E.B. Eddy
Manufacturing Co. fut malheureusement très affectée par la crise économique des années
1930. Elle y survécut tout de même et prospéra par la suite. partir de 1886, Ezra Butler Eddy innova dans
l'industrie du traitement des produits forestiers ; il fut un véritable pionnier dans
l'utilisation de nouveaux procédés industriels, telles la fabrication de la pâte
mécanique et chimique et l'utilisation de lessiveuses en forme de tour. E.B. Eddy
Manufacturing Co. fut malheureusement très affectée par la crise économique des années
1930. Elle y survécut tout de même et prospéra par la suite.La majorité de la population de l'Outaouais vivait encore à la campagne
jusqu'en 1930. La région, tout en conservant son expertise dans le sciage du bois, devint
un leader de l'industrie des pâtes et papiers et de l'industrie minière par l'extraction
et le traitement du phosphate, puis du mica et du feldspath.
Les infrastructures de transport évoluèrent aussi, passant des voies
maritimes au chemin de fer, puis au transport routier. |
 |
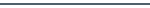 |
|
Au
XX ième siècle, une région tournée vers l'avenir |
|
 u cours de la phase
d'industrialisation, le gros de la population se déplaça vers le sud urbanisé et la
rivière des Outaouais. Tout au cours de la période allant de 1891 à 1921, Hull, centre
administratif de l'Outaouais, demeura le troisième centre urbain du Québec, après
Montréal et Québec. La région acquit un paysage linguistique particulier où les
groupes ethnolinguistiques se regroupèrent en poches relativement homogènes. A
l'ouest, le Pontiac était britannique tandis qu'à l'est, le canton de Papineau était
majoritairement canadien-français (comme on disait alors). Au centre, de 1870 à
1940, la zone Gatineau-Hull passa d'une forte présence britannique à une diversification
ethnique marquée. L'hétérogénéité caractérisa aussi l'environnement religieux ;
diverses confessions coexistèrent de façon pacifique. u cours de la phase
d'industrialisation, le gros de la population se déplaça vers le sud urbanisé et la
rivière des Outaouais. Tout au cours de la période allant de 1891 à 1921, Hull, centre
administratif de l'Outaouais, demeura le troisième centre urbain du Québec, après
Montréal et Québec. La région acquit un paysage linguistique particulier où les
groupes ethnolinguistiques se regroupèrent en poches relativement homogènes. A
l'ouest, le Pontiac était britannique tandis qu'à l'est, le canton de Papineau était
majoritairement canadien-français (comme on disait alors). Au centre, de 1870 à
1940, la zone Gatineau-Hull passa d'une forte présence britannique à une diversification
ethnique marquée. L'hétérogénéité caractérisa aussi l'environnement religieux ;
diverses confessions coexistèrent de façon pacifique. Au
tournant du XIX ième siècle, les décisions gouvernementales influençaient déjà
profondément le développement de l'Outaouais. Après la politique de peuplement qui
suivit la guerre de 1812, la construction du canal Rideau entre Bytown et Kingston fournit
une voie d'accès commerciale entre Montréal et les Grands Lacs.
L'histoire récente de l'Outaouais puise beaucoup dans sa proximité de
la capitale canadienne. En fait, depuis les années 1940, l'évolution de l'Outaouais a
été d'abord marquée par le développement de l'administration publique, puis des
industries. Les politiques gouvernementales ont contribué à l'essor régional tant
par la croissance phénoménale de l'emploi qui y était liée que par la réflexion
qu'elle exigea dans le domaine de l'aménagement du territoire. Au cours des trente
dernières années, l'emploi se déplaça du secteur manufacturier vers l'administration
publique, pour maintenant s'orienter vers les services aux entreprises et les industries
de pointe.
La population outaouaise a continué à croître au cours des cinquante
dernières années, s'établissant à 307 441 personnes en 1996, soit quelque
4,5 % de la population québécoise, alors que l'Outaouais comptait quelque
119 000 habitants en 1941, donc 3,6 % de la population du Québec. Diversité,
dynamisme et confiance caractérisent cette population fière de sa communauté.
De zone de passage, puis d'enclave axée sur les ressources naturelles,
l'Outaouais est devenu un grand centre pour l'administration publique et, plus récemment,
un milieu propice à l'innovation et aux industries de pointe. L'Outaouais compte
aujourd'hui sur une infrastructure de communications physiques et électroniques parmi les
meilleures, aussi bien en regard des standards nord-américains qu'internationaux. |
|
  |
|
(Moteur de
recherche) -----Passeport pour l'Outaouais----- OK |
|
|
|